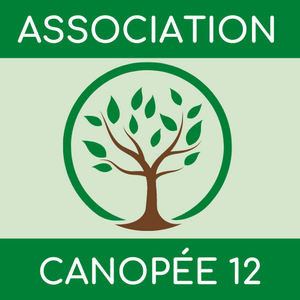« Notre planète est unique et fragile, protégeons-la ! »

La surexploitation des ressources naturelles par l’humanité entraîne de nombreux problèmes environnementaux, tels que la déforestation, la perte de biodiversité, la pollution et le changement climatique.
Pour préserver notre planète, il est essentiel d’adopter des modes de consommation plus durables, de promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage, ainsi que de soutenir des politiques environnementales responsables.
Nous consommons plus de ressources que la Terre ne peut en régénérer.
À l’échelle mondiale, les ressources naturelles que constituent l’eau, les sols, les terres, les forêts, la biodiversité, les minéraux et métaux, ainsi que les ressources énergétiques (pétrole, charbon, gaz naturel) sont utilisées chaque jour pour répondre aux besoins humains. Certaines peuvent se renouveler mais elles ne sont pas infinies, et leur surexploitation se produit quand leur extraction dépasse leur régénération (surexploitation). –> Ces ressources naturelles ne sont pas infinies !
Aujourd’hui, nous utilisons les ressources naturelles 80 % plus rapidement que la capacité de régénération de la Terre, entraînant ainsi une dégradation accélérée des écosystèmes, une perte de la biodiversité et une diminution des ressources disponibles pour les générations futures.
« L’extraction annuelle de plus de 60 milliards de tonnes de ressources, qu’elles soient renouvelables ou non, illustre l’ampleur de notre consommation et la pression exercée sur notre planète. Il est donc crucial d’adopter des pratiques plus durables, telles que la réduction de notre empreinte écologique, le recyclage, l’économie circulaire et le développement de sources d’énergie renouvelables, afin de préserver l’équilibre de la planète et garantir un avenir viable pour tous. » (Rapport OFB de 2019).
Les ressources renouvelables, ce sont des ressources naturelles dont le stock peut se reconstituer naturellement sur une période courte à l’échelle humaine de temps et en se renouvelant au moins aussi vite qu’elles sont consommées :
-
- L’eau (rivières, nappes souterraines)
- Le soleil
- Le vent
- La géothermie
- La mer
- La biomasse (matière organique d’origine végétale, animale, bactérienne ou fongique)
- Les plantes (arbres, végétation, humus)
- La faune (animaux)
- …
Les ressources non renouvelables ou épuisables, ce sont des ressources qui se reconstituent très lentement et/ou ne se régénèrent pas à l’échelle humaine de temps. Leur utilisation excessive peut entraîner leur disparition :
-
- Les minéraux (métaux, argent, cuivre, or, etc…)
- Le charbon
- Le pétrole
- Le gaz naturel
- Les sols
- …
Les ressources renouvelables et la production d’énergie
Les énergies renouvelables viennent de sources naturelles qui se renouvellent rapidement : le vent (éolien), l’eau (hydraulique), le soleil (photovoltaïque), la biomasse (bois, déchets végétaux ou animaux), la chaleur de la terre (géothermie), etc…
L’éolien, le solaire, l’hydraulique ou encore la biomasse sont bien moins néfastes pour l’environnement et sont faiblement émettrices de gaz à effet de serre. Par contre, leur caractère intermittent (pas de production d’énergie en continu) pose certains problèmes pour assurer une bonne continuité de l’approvisionnement en énergie (pas ou peu de stockage de l’énergie produite).
L’énergie solaire est l’énergie produite grâce aux rayons du soleil. Elle peut être photovoltaïque ou thermique. Dans le premier cas, de l’électricité est produite via des panneaux photovoltaïques ; dans le second, c’est de la chaleur qui est générée via les panneaux solaires.
L’énergie solaire est dite « propre » : la production d’électricité ou de chaleur via les panneaux solaires n’émet aucun gaz à effet de serre ce qui n’est pas le cas de leur fabrication.

« Comme tout produit industriel, une cellule photovoltaïque est nécessairement constituée de divers matériaux dont l’extraction n’est pas neutre du point de vue environnemental et social. La très grande majorité des panneaux solaires sont constitués de silicium cristallin, élément que l’on extrait du sable ou du quartz et qui, comme le verre, est 100 % recyclable. Ces panneaux solaires contiennent aussi des éléments en argent, en aluminium ou en cuivre et, selon les modèles, du plastique. Ils couvrent 90 % du marché du solaire.
Il est pourtant aujourd’hui possible de limiter considérablement les impacts environnementaux et de recycler les produits issus des opérations de raffinage, ce que font de plus en plus d’entreprises. Les producteurs européens – dont les Français – ont aussi un rôle à jouer dans la prise en compte des impacts environnementaux de la filière photovoltaïque tout au long de la chaîne de production.
Aujourd’hui, au terme de leur durée de vie optimale (estimée à environ 25 ans, période au cours de laquelle au moins 80 % de leur puissance initiale est garantie) les panneaux photovoltaïques, qu’ils aient été construits en Chine ou en Europe, sont recyclables entre 95 et 99 % pour la plupart des constructeurs. » (source GreenPeace « Quel est l’impact environnemental des panneaux solaires« )
–> EDF » L’impact environnemental des panneaux solaires en questions «
–> Encyclopédie de l’énergie » Solaire photovoltaïque : quel impact sur l’environnement ? «
–> Actu Environnement » Panneaux solaires : quel impact sur l’environnement ? «
–> La Vie » Le côté sombre du solaire «
L’énergie éolienne est l’énergie produite en utilisant la force du vent pour générer de l’électricité à travers des éoliennes.
Une éolienne est une machine permettant de transformer l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique, elle-même convertie en électricité. Il existe des éoliennes terrestres et en mer.

« Comme toutes les énergies, les éoliennes ont un impact sur l’environnement qui n’est pas neutre. Une éolienne n’émet pas de CO2 lorsqu’elle produit de l’électricité mais il faut tenir compte de son empreinte carbone en amont (fabrication et transport) et en aval (démontage et recyclage).
Selon une étude de l’ADEME publiée en 2015 sur l’analyse du cycle de vie des éoliennes en France, l’éolienne terrestre émet en moyenne 12,7 g de CO2 par kWh, et l’éolien maritime 14,8 g de CO2 par kWh, valeurs proches de celles avancées par le GIEC. L’impact carbone de l’éolien varie en fonction de sa durée de vie et des distances de transport des pièces (notamment pour l’éolien offshore qui suppose du transport maritime).
France Nature Environnement a rédigé une grille de critères très précise pour l’éolien terrestre, l’Eoloscope, et pour l’éolien en mer l’Eoloscope Offshore (répartition sur le territoire et prise en compte des questions de biodiversité et de démocratie). Selon les études de l’ANSES, de,l’INRA et du GPSE, les champs électromagnétiques générés par les lignes à haute ou moyenne tension, les transformateurs, les éoliennes ou autre source électrique peuvent créer des courants parasites au-delà d’un certain seuil qui peuvent gêner ou affecter les animaux des exploitations agricoles situées à proximité, c’est un problème sérieux qui concerne toutes les sources d’énergie électrique.
Les éoliennes ont une durée de vie moyenne de 20 à 30 ans et plus de 90 % de son poids est recyclable à 100 %.
Certains parcs éoliens, généralement les plus anciens, peuvent en effet avoir une influence sur la biodiversité. Cependant, une étude sur l’impact de l’éolien publiée par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) en 2017 montre que la mortalité des oiseaux due aux éoliennes est relativement faible lorsque les projets évitent les secteurs présentant de forts « enjeux avifaunes. » (source GreenPeace « Quel est l’impact environnemental des éoliennes ?« )
–> BPI France » Energie éolienne : définition, fonctionnement et impact des parcs éoliens «
–> France Nature Environnement » Eolien terrestre : enjeux et impacts «
–> Reporterre » Quel est l’impact des éoliennes sur l’environnement ? Le vrai, le faux «
La biomasse énergie est une source d’énergie qui exploite certaines matières organiques animales (fumier, lisier, biodéchets,…) ou végétales (bois, feuilles,…) pour créer de l’énergie. Elle permet de générer de la chaleur, de l’électricité et du carburant selon le mode de transformation employé : combustion, méthanisation etc…
La biomasse solide est donc une alternative durable au chauffage au gaz naturel ou au charbon ! Enfin, la biomasse peut servir à la production de biocarburants : biodiesel ou bioéthanol.

« Le caractère renouvelable de la ressource biomasse vient du fait que le CO2 dégagé par la combustion des bioénergies est compensé par le CO2 absorbé par les végétaux lors de leur croissance. Sur une analyse de cycle de vie de la ressource, son utilisation est donc neutre en carbone, au contraire des énergies fossiles (charbon, pétrole, et gaz) dont l’exploitation et l’utilisation produit un nouveau stock de gaz à effet de serre rejeté dans l’atmosphère.
La ressource biomasse nécessite plus de temps pour se reconstituer (temps de pousse des arbres, des cultures énergétiques, etc.).
L’utilisation de la biomasse peut également dans certains cas engendrer des déséquilibres environnementaux. Notamment, la déforestation massive, la concession de parcelles à l’industrie des biocarburants ou du biogaz réduit par endroits la taille des terres agricoles destinées à l’alimentation et des sources de biodiversité pour faire de la monoculture intensive. L’utilisation de biomasse par combustion, de biogaz, de biocarburant rejette des gaz à effet de serre et des particules fines. » (source Echo Sciences Grenoble « Débats sur le caractère renouvelable et bas carbone de la biomasse« )
–> Commission Régulation Energie » La biomasse et la neutralité carbone «
–> Carbone4 » Le vrai du faux sur les bioénergies et le climat «
–> Encyclopédie de l’énergie » Biomasse et énergie : des ressources primaires aux produits énergétiques finaux «
–> BPI France » Énergie biomasse : définition, fonctionnement, avantages «
–> Novethic » La biomasse, un sujet à haute tension pour réussir la transition énergétique «
L’énergie géothermique est une source d’énergie qui exploite la chaleur naturelle du sous-sol de la Terre.
Cette chaleur, emmagasinée dans le sous-sol et les nappes d’eau souterraines, peut être utilisée directement pour le chauffage ou transformée en électricité. En fonction de la température de la ressource et du niveau de température des besoins thermiques, la chaleur peut être prélevée directement (on parle alors de « géothermie directe ») ou valorisée au moyen de pompes à chaleur.

« Les installations de géothermie de surface rejettent, en moyenne, moins de 45 g équivalent de CO2 par kWh de chauffage (émissions associées à la consommation électrique de la pompe à chaleur (ADEME, 2016). C’est environ 4 fois moins que les installations classiques utilisant l’électricité, 6 fois moins que celles consommant du gaz naturel et 7 fois moins que celles au fioul pour le chauffage.
La géothermie de surface valorise l’énergie renouvelable du sous-sol.
Les coûts d’investissement dans les installations avec pompes à chaleur géothermiques sont plus élevés que pour une installation fonctionnant avec des énergies traditionnelles en raison des coûts liés aux forages. En revanche, les coûts d’exploitation sont très faibles et stables dans le temps. Ils se composent des coûts d’entretien de l’installation et de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur (PAC) et de ses auxiliaires. » (source La Géothermie « La géothermie, une énergie renouvelable & compétitive« )
–> La Géothermie » Les technologies de géothermie de surface » , » Géothermie profonde, fonctionnement et technologies «
–> Aubade » Quels sont les avantages et inconvénients de la géothermie ? «
–> Plenitude magazine En Lumière » Quels sont les avantages et les inconvénients de l’énergie géothermique ? «
La biodiversité désigne l’ensemble de la diversité biologique présente sur l’ensemble de la Terre, incluant la variété des espèces vivantes (plantes, animaux, micro-organismes), la diversité génétique au sein de chaque espèce, ainsi que la diversité des écosystèmes (forêts, océans, zones humides, déserts, etc.).
Elle constitue un patrimoine naturel essentiel qui soutient les processus vitaux de la planète, contribue à la stabilité des écosystèmes et fournit des ressources indispensables à la survie humaine.
La biodiversité, constitue le tissu vivant de notre planète, c’est-à-dire l’ensemble des êtres vivants et leurs écosystèmes.
En raison de l’activité humaine, les espèces végétales et animales qui font partie de cette biodiversité, disparaissent à un rythme effréné.


Les pressions exercées par les activités humaines sur la biodiversité sont nombreuses, menacent l’existence de milliers d’espèces végétales et animales et accélèrent l’effondrement de la biodiversité :
– la destruction et l’artificialisation des milieux naturels (forêts, prairies, sols, surexploitation des ressources naturelles (surpêche, exploitations forestières, braconnage, …),
– l’agriculture intensive : qui épuise les terres (40 % des sols sont désormais dégradés),
– l’agriculture et l’élevage : qui accaparent environ 75 % des ressources en eau douce,
– l’artificialisation des sols (habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements publics…),
– la pollution des milieux aquatiques (océans, eaux douces),
– la pollution de l’air et des sols (pesticides, métaux lourds, résidus médicamenteux, nanoparticules, ondes électromagnétiques, macro-déchets, micro-plastiques),
– le dérèglement du climat,
– …
–> Ministère de l’écologie » Biodiversité : présentation et enjeux » , » La biodiversité : victime et solution du changement climatique «
–> Biodiversité.gouv » Les 5 pressions responsables de l’effondrement de la biodiversité «
–> Office Français Biodiversité » La biodiversité, c’est toute la vie » , » La biodiversité en danger «
L’énergie hydraulique est une source d’énergie qui exploite le mouvement et la force de l’eau issu de fleuves, rivières ou chutes d’eau pour produire de l’électricité.
L’électricité est produite par le mouvement de l’eau, qui exerce une force sur des turbines entraînant un générateur électrique.

« L’eau circule en permanence sur notre planète sous ses formes liquide, solide (neige, grêle, glace) et gazeuse (vapeur d’eau). L’eau occupe environ 71 % de la surface de la Terre et 97,2 % de cette eau est salée.
L’eau douce représente moins de 3 % du volume d’eau de la planète. La majeure partie de cette eau douce est gelée (glaces des pôles, glaciers, neiges éternelles,…). Au total, seulement 0,6 % de l’eau de la planète est de l’eau douce disponible.
Les prélèvements sur la ressource en eau peuvent conduire à des modifications importantes du débit des rivières ou du niveau des nappes et entraîner des conflits d’usages entre eau potable, industrie, agriculture, loisirs et biodiversité. »
L’eau est une ressource renouvelable mais pas illimitée.
–> Centre d’information sur l’eau » Quelles sont les ressources en eau dans le Monde ? » et » Pourquoi l’eau n’est-elle pas une ressource inépuisable ? «
–> INRAE » L’eau, une ressource vitale «
Les énergies marines comprennent l’ensemble des technologies permettant de produire de l’électricité à partir des courants, des marées et de la houle :
-
- L’énergie hydrolienne est une source d’énergie qui utilise l’énergie cinétique des courants marins (sous-marin ou à flot).
- L’énergie marémotrice est une source d’énergie qui exploite les mouvements périodiques des océans, les marées. Cette source d’énergie est exploitée dans les endroits où les marées sont de fortes amplitudes.
- L’énergie houlomotrice, ou énergie des vagues, est une source d’énergie marine qui utilise l’énergie contenue dans le mouvement de la houle ou les oscillations de la surface de l’eau.


–> Connaissance des Energies » Energies marines « , » Hydroliennes « , » Marémotrice « , » Houlomotrice «
–> BPI France » Energie hydrolienne: fonctionnement, avantages, source d’électricité renouvelable «
–> BPI France » Énergie marémotrice : fonctionnement des usines et avantages «
–> Géo Littoral » Autres énergies marines renouvelables «
–> Cerema » Le renouveau de l’énergie des vagues «
–> BPI France » L’énergie houlomotrice : les vagues au service de la production électrique «
Les ressources non renouvelables
Les plantes et autres organismes en décomposition, enfouis sous des couches de sédiments et de roches, ont mis des millions d’années à devenir les gisements riches en carbone que nous appelons maintenant les énergies fossiles.
Le charbon, le pétrole et le gaz naturel, fournissent environ 80 % de l’énergie mondiale. Ils fournissent de l’électricité, de la chaleur et du transport, tout en alimentant les processus qui créent une vaste gamme de produits, de l’acier aux plastiques. Ces énergies fossiles jouent un rôle crucial dans notre vie quotidienne et elles sont épuisables.
La combustion des énergies fossiles émet des gaz à effet de serre (GES) entraînant un réchauffement de la planète et des changements climatiques.


Le sol représente la couche supérieure de la couche terrestre, une couche très mince au regard du diamètre de la planète. Il est composé de débris de roches, de grains de sable et d’argile, de morceaux de plantes et d’animaux morts. Entre ces éléments, il y a plus ou moins d’espace où circulent l’air et l’eau et où vivent une multitude d’êtres vivants.
Le sol est la base de la vie pour tous les êtres vivants : il filtre et stocke l’eau. Il participe aux cycles de l’azote, du phosphore et du potassium, éléments nécessaires au développement des plantes et des cultures. Le sol est un puit de carbone indispensable. Le sol permet de nourrir les êtres humains. Il apporte des matières premières essentielles pour toutes nos activités mais ces ressources sont limitées et s’épuisent.
Les sols sont menacés par les activités humaines : agriculture intensive, tassement des sols, imperméabilisation (route, parking, habitations, entrepôts, …), déforestation, pollution, …


Les métaux existent en quantité limitée dans des minerais (cuivre, lithium, cobalt, sélénium, gallium et indium,…). L’exploitation des métaux nécessite l’extraction de tonnes de roches pour quelques kilogrammes de métaux et d’immenses quantités d’eau pour les purifier, dans des zones parfois arides ou semi-désertiques.
Certains métaux sont devenus indispensables à l’industrie, aux nouvelles technologies ou à la production d’énergies renouvelables (batteries de téléphones, batteries des voitures électriques, alternateurs des éoliennes, panneaux solaires, data center, ordinateurs,…). Ces métaux ne sont pas disponibles partout sur Terre, mais uniquement dans quelques régions du monde.
Certains de ces métaux risquent d’entrer en pénurie, comme le lithium dont la demande pourrait être multipliée par 40 d’ici 2040. Une grande partie de nos appareils numériques utilisent des métaux dont la quantité est limitée sur Terre.

Le pétrole est massivement utilisé car il est très énergétique et facile à transporter. Il est issu de la sédimentation de matières organiques pendant la période mésozoïque.
Cependant, les ressources pétrolières sont limitées. Son exploitation porte atteinte à l’environnement (forage, marées noires) et sa combustion est extrêmement émettrice de dioxyde de carbone.
–> WE Demain » Derrière chaque baril de pétrole, un impact climatique très inégal «

Le gaz naturel est moins facile à transporter et à utiliser que le pétrole. Il a un fort pouvoir énergétique qui le rend intéressant pour le chauffage et la production d’eau chaude.
Il provient lui aussi de la décomposition de matières organiques vieilles de plusieurs millions d’années. Bien que sa combustion soit moins émettrice de gaz à effet de serre que le pétrole, l’exploitation du gaz naturel a un impact sur l’environnement : extraction gourmande en eau, émissions de méthane, etc…
–> GreenPeace » Climat : pourquoi faut-il sortir du gaz ? «

Le charbon est utilisé par certains pays pour produire de l’électricité et de la chaleur. Sa formation résulte elle aussi de la dégradation des matières organiques souterraines.
Aujourd’hui, en raison de son fort impact polluant, le charbon sert essentiellement à produire de l’électricité via les centrales thermiques. Il est également utilisé pour le chauffage domestique.
–> Connaissance des Energies » Charbon : quels dangers ? «

Les principaux gisements d’uranium se trouvent en Australie, au Canada, en Russie, au Niger, en Afrique du Sud, en Namibie, au Brésil et au Kazakhstan et en Mongolie. L’uranium est vital pour l’industrie nucléaire.
Une centrale nucléaire produit du courant électrique à partir d’une source chaleur provoquée par une réaction nucléaire. La fission des atomes d’uranium libère de l’énergie, cette énergie chauffe de l’eau sous haute pression qui se transforme en vapeur très chaude. Cette vapeur entraîne une turbine qui va mettre en mouvement un alternateur qui produit du courant électrique.
L’énergie nucléaire résulte de la fission de l’uranium et du plutonium (des minerais radioactifs contenus dans le sous-sol de la terre) qui produit une puissante réaction en chaîne. Elle sert à produire de l’électricité en émettant peu de gaz à effet de serre (GES).
L’énergie nucléaire permet une production électrique constante et n’émet pas de gaz à effet de serre lors de son utilisation.
Par contre elle a quelles points négatifs : dépendance des ressources limitées en Uranium, difficulté de traitement des déchets radioactifs, gestion des rejets d’eau chaude dans l’environnement et risque d’accident nucléaire.
Une piste pour le recyclage des déchets : « Des scientifiques américains développent une méthode de recyclage des déchets nucléaires dans l’objectif de produire du tritium, une forme rare d’hydrogène. C’est un combustible essentiel pour les réacteurs à fusion. »
–> CEA » L’énergie nucléaire en 14 questions «
–> BPI France » Énergie nucléaire : définition, fonctionnement, avantages «
–> GreenPeace » Le nucléaire est-il une solution pour le climat ? «
—– Pour économiser les ressources de notre planète, —-
—- Nous devons repenser nos modes de vie… —–
- Optimiser sa consommation énergétique
- Rénover et isoler ses logements
- Réduire son chauffage
- Limiter sa consommation d’eau
- Débrancher ses appareils électriques quand c’est possible
- Lutter contre la pollution numérique (emails, streaming, IA, cloud, réseaux sociaux,…)
- Limiter et recycler ses déchets organiques
- Se déplacer autrement (transport en commun, auto partage, vélo, à pied)
- Limiter les déplacements en avion
- Opter pour une alimentation saine et responsable, limiter sa consommation de viande
- Réduire notre utilisation du plastique
- Limiter sa consommation d’achat en textile
- Réduire sa consommation d’appareils électroniques et les recycler de façon responsable
- Penser à composter ses déchets alimentaires
- …
–> Nations Unies » Actions pour une planète prospère «
–> IdVerde » 10 actions à mettre en place pour protéger la planète au quotidien «
–> Hellocarbo » 21 actions concrètes pour protéger l’environnement «
–> Ministère Ecologie » Pour la planète, chaque geste compte «
Liens sur ce sujet :
- WWF : « La surconsommation menace notre planète »
- Office Français Biodiversité : « La surexploitation des ressources »
- Rivaje : « Le jour du dépassement, qu’est-ce que c’est ? »
- Conso Globe : « Epuisement des ressources naturelles »
- Agir pour la Transition : « 24 juillet 2025 : jour du dépassement »
- Ministère Transition écologique : « Focus ressources naturelles partie 1 » (pdf)
- Ministère Transition écologique : « Focus ressources naturelles partie 2 » (pdf)
- Ministère Transition écologique : « Focus ressources naturelles partie 3 » (pdf)
- Notre environnement : « Les conséquences de l’utilisation des ressources naturelles sur l’environnement »
- M ta terre : « Ressources naturelles »
- Futura : « Surexploitation des ressources terrestres »
- Industrie Minière : « Réserves de minerais : Les régions les plus riches en ressources naturelles »
- Alloprof : « Les ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables »
Liens sur ce sujet :
- ONU : « Nous engloutissons les ressources de la planète Terre à un rythme insoutenable »
- ONU : « Les pays riches utilisent six fois plus de ressources et génèrent dix fois… »
- Notre environnment : « L’utilisation des ressources naturelles »
- Les Cahiers développement durable : « Des ressources menacées d’épuisement »
- FAO : « L’état des ressources en terres et en eaus pour l’alimentation et l’agriculture » (pdf)
- L’info durable : « Ces ressources naturelles qui commencent à nous faire défaut »
- Statista : « Nombre de planètes Terre nécessaires selon le rythme de vie des populations… »
- Statista : « L’extraction de minerais dans le monde – Faits et chiffres »
- INRAE: « L’eau, une ressource vitale »
- Reporters sans Frontières : « Deux tiers des ressources naturelles mondiales sont extraites dans des pays où … »
- Earth-Info : « Epuisement des ressources naturelles »
Article modifié par « Canopée » le 18/01/2026